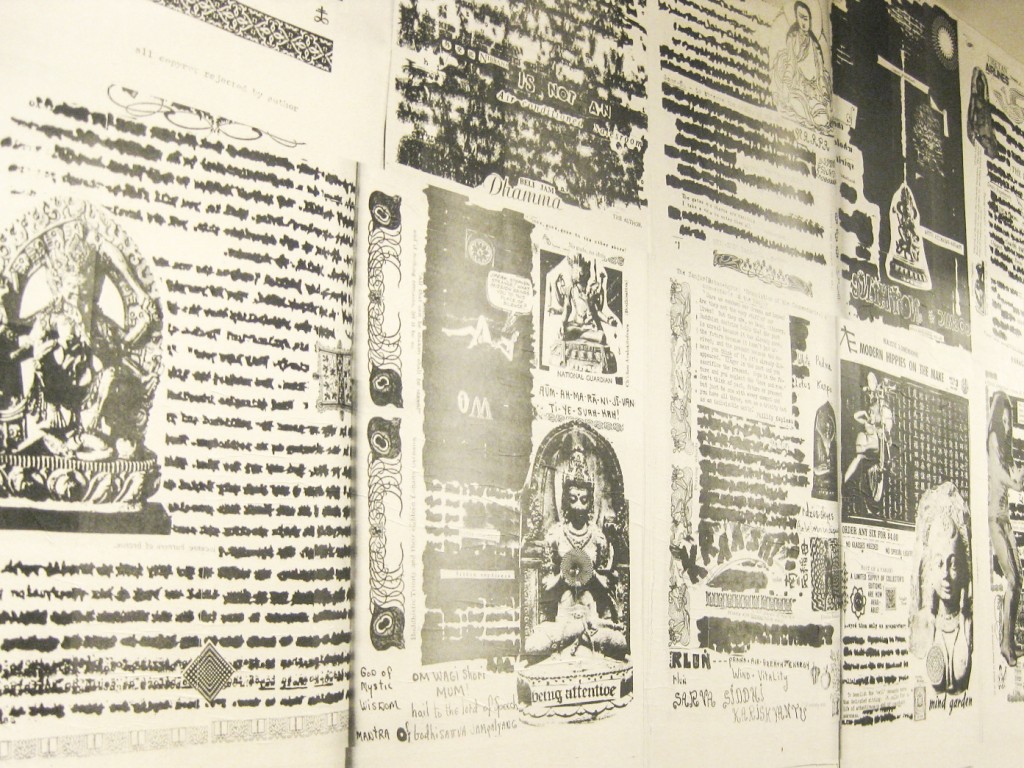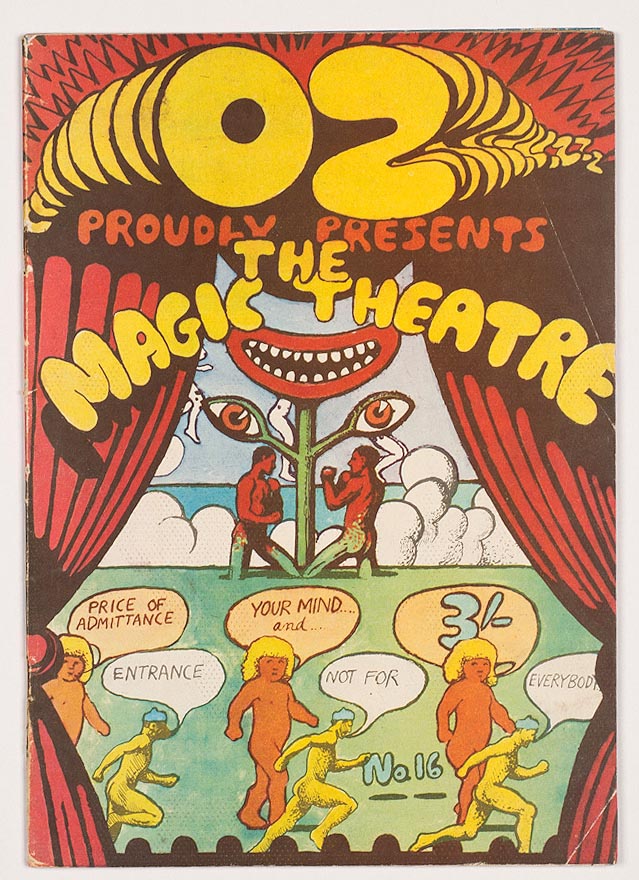11/04/2015 |
Par Théodore Sutra-Fourcade et Hugo Serraz

L’exposition Recto/Verso s’est déroulée du 21 mai 2014 au 1er février 2015 au Musée des arts décoratifs de Paris. Elle retrace les expérimentations de huit graphistes ou collectifs à travers leur travail de commande et leurs recherches personnelles. Akatre, Jocelyn Cottencin, Helmo, Christophe Jacquet, Fanette Mellier, Mathias Schweizer, Pierre Vanni et Vier5 retracent ainsi leurs démarches d’auteurs et mettent en scènes les processus de création qui animent une production plurielle entre contraintes et expression propre.
À la suite de cette visite nous avons pu rencontrer le studio Akatre et débattre avec eux de leur expérience du graphisme dans le milieu français et à l’étranger.
[RENCONTRE]
Ça fait longtemps que vous êtes installés ici à Saint-Ouen ?
Seulement quelques années. Il nous fallait un atelier nous permettant d’être autonomes. Nous avons été en résidence à Mains d’œuvres, ancien vaste complexe sportif des usines Valéo (4000 m2, à Saint-Ouen – NDLR) réhabilité en centre de ressources culturelles. Ce lieu un peu « destroy » nous a permis d’avoir la place d’expérimenter, de produire nos formes.
Comment travaillez-vous aujourd’hui ? Les journées sont-elles longues ?
Ça c’est fini ! Lorsque nous avons monté la boite, elle occupait toutes nos pensées, jour et nuit. Ça a été soirées et weekend de travail pendant bien deux ou trois ans. La productivité est quelque chose qu’on apprend au fur et à mesure. Aujourd’hui nous avons des journées très calées : heure de début, heure de fin, quelque soit l’urgence des commandes. Mais ça a été beaucoup d’investissement, de sacrifices, et on a vieilli d’un coup à certaines périodes.
Ce studio, vous l’avez monté tout de suite après les études ?
Presque, oui. Chacun est parti en stage pendant un certain temps. Essentiellement des studios qui travaillent pour la culture. Chaque expérience a nourri le collectif : signalétique, édition, proposition d’une charte graphique, réponse à un appel d’offre.
[AU SUJET DE RECTO/VERSO ET LES FORMES DE L’HISTOIRE]
Dans la commande, les tenants et les aboutissants sont en partie formulés par le commanditaire. Dans les projets personnels, vous êtes au contraire à l’initiative, quels sont vos points de départ ?
Dès nos débuts notre philosophie consistait à créer toutes les formes que l’on utilisait, aussi par manque de moyens (typographie, photo, vidéo, volume, mise en scène) ce qui aboutit à des réponses très personnelles et singulières. Cela apporte une part de subjectivité dans des commandes souvent très strictes. Aux yeux du grand public, cela peut sembler subtil ou même invisible mais ça s’inscrit en réalité dans une démarche de créateur sous-jacente. Chez Intégral (studio parisien fondé par Ruedi Baur – NDLR) on appelle ça le «concept évolutif».
C’est l’enjeu du graphisme : véhiculer le message du client ainsi que son propre message.
Exactement.
Dans l’exposition, il est dit que le travail du graphiste ne se résume pas seulement à un savoir-faire et à une réponse motivée pas les spécificités de la commande, il y investit également ses propres questionnements, recherches, et obsessions. Il n’est pas simple technicien mais bien auteur.
Bravo ! (applaudissements)
Et lorsque l’on vient vous voir, dans le cadre d’une commande, est-ce dans cette optique là, ou n’est-ce pas si évident ?
Pas si évident, non. Souvent, le client se réfère à ce que l’on a déjà fait, et nous demande la même chose. Ce n’est pas tant pour une reflexion d’auteur que l’on est sollicité mais pour un travail déjà établi qui collerait à la commande. Ou alors, le client vient vers nous pour la singularité de notre point de vue mais demande de la retenue. Il cherche plus à s’associer à notre image qu’à nous confier la leur. Mais nous, on ne marche pas comme ça (rires). Dans ce cas, autant racheter les droits d’une image ! On se plaint aujourd’hui d’un manque de culture de l’image, de la pauvreté de ce que l’on voit dans le métro mais c’est notre devoir de faire changer les choses, à notre petite échelle. Nous somme là non pas en exécutant mais bien pour donner un avis sur une direction artistique, sinon on ne fait pas bien notre travail. Comme un médecin qui vous diagnostique un cancer, à un moment quelqu’un doit vous dire que ça va mal. Mais avant même de commencer à travailler, il y a beaucoup à faire. éduquer le client, lui rappeler notre rôle, lui expliquer nos méthodes de travail et même dire les choses qui fâchent.
Y a-t-il des clients qui se replient dès cette étape ?
Oui, ça arrive ! Lorsque l’on vient nous voir pour des bribes d’identités visuelles : un logo, un site par exemple. Il existe des commandes bancales que l’on démasque tout de suite.
Pour revenir à la culture de l’image, on voit que d’un point de vue théorique il n’existe pas de formation d’historien du graphisme en France, comment éduquer le grand public ?
Oui, c’est méconnu. Nous menons ce combat à notre échelle. Le problème reste que la majorité des images produites sont publicitaires et donc régies par le marketing, à la recherche du profit et non de la création. Nous, les petits créateurs, nous battons contre Goliath. La situation économique n’améliore pas les choses, il y a une crise de l’engagement. Les chargés de communication n’osent plus affirmer les choix des graphistes qu’ils ont engagés et défendre leurs propositions face à la direction. C’est le payeur qui décide.
L’exposition Recto-Verso s’interroge sur le statut de la pièce graphique qui perd de son aura, de part la reproduction et sa large diffusions. Comment lui redonner de la valeur ?
Nous avons toujours essayé d’optimiser les budgets afin de créer un véritable objet. Dans l’édition par exemple, le poids, la manipulation, ces choses simples font la différence. En France, faites un tour dans une librairie, tous les livres son standardisés : couverture de la même taille, rigides…
…en quadri…
…il y a juste le titre qui change. Au Pays-Bas, ce n’est pas pareil, on prend une claque !
En tant que graphistes, vous avez du mal à affirmer vos choix, qu’en est-il lorsque vous mettez le pied dans l’art contemporain ?
Dans les Galeries Lafayette où nos photos seront exposées, ou à Recto/Verso, nos propositions sont prises telles quelles, avec le respect du travail d’artiste. On peut même demander à faire repeindre le mur ! Complètement l’opposé de la commande de graphisme, c’est le jour et la nuit !
Grâce à ça, pensez-vous que vous gagnez du respect en tant que graphistes également ?
Pas du tout, les gens s’en fichent. On se rend compte sur certains projets complexes qu’on reste un maillon de la chaîne. Ce respect, on est obligé de le gagner sur chaque projet. à l’inverse, à l’étranger, l’accueil est radicalement différent. Lorsqu’on vend une photo, même à New York, on a des retours très chaleureux. Ce n’est pas anodin que Gestalten, éditeur allemand, a publié notre monographie. On a que de rares exemples du success story en France, comme M/M (Paris) qui jouit d’une grande renommée aussi bien ici qu’ailleurs. De même, il existe à l’étranger de grosses agences qui produisent du graphisme de qualité pour des commanditaires privés, chose que l’on ne voit que trop peu en France.
On aimerait voir de belles choses partout dans la rue, jusqu’aux enseignes de commerces de proximité, on pense à Monoprix par exemple (identité visuelle refondue en mars 2012 par agence Rosapark – NDLR)
Comme graphistes vous avez l’avantage d’être confrontés sans cesse à de nouvelles situations mais qu’en est-il lorsque la création est beaucoup plus libre, lorsque vous vous faites artistes ?
Il y a ce tabou terrible en France. L’artiste est lui aussi sujet à la commande : par rapport à une création in situ, des engagements de vente vis à vis d’une galerie. La condition de création est la même.
En effet les termes « beaux-arts » et « arts appliqués » trahissent, en France une séparation des pratiques, pourquoi tant de clivages ?
On a rencontré des artistes de milieux anglo-saxons ayant fait de la scéno, du graphisme, de la musique, quelle richesse ! Là-bas c’est évident ! Nous en France, quand on est un studio de graphistes, on fait des livres pour la culture et des programmes de théâtres, point (rires). On aimerait aussi ne plus avoir à défendre, comme à Recto-Verso, nos choix plastiques.
[AKATRE DEMAIN]
Vous connaissez peut être la métaphore de Paula Scher de l’escalier biscornu ? Dans ce contexte, et après quelques années de présence sur la scène du graphisme, arrivez-vous encore à monter les marches ?
Nous sommes justement à un tournant. Les marches s’allongent, on ne sait pas vraiment où sera la prochaine. Notre réseau s’est fait par étapes mais pour aller plus haut, il faut être introduit. Dans la musique, l’art contemporain, la vidéo, autoproduire avec les moyens du bord est une chose, mais il faut des commandes et de vrais budgets pour monter la marche suivante. On attend maintenant un perfectionnement technique, les bonnes idées ne suffisent plus. On y arrive dans l’édition et la photo mais d’autres champs restent à conquérir.
Propos recueillis à l’oral le 28/11/14